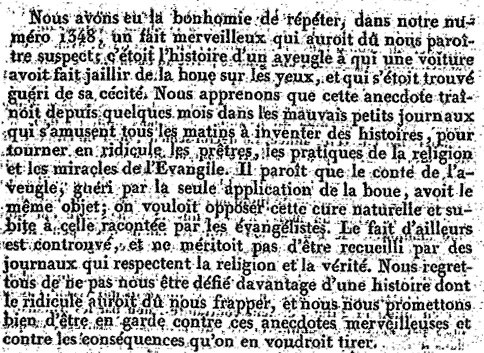Dans un numéro récent du Monde, à la question “Faut-il ouvrir le mariage aux couples de même sexe ?”, Catherine Labrusse-Riou, professeure de droit à l’université Paris-I, répond :
J’y suis opposée, comme juriste et comme citoyenne. Les tribunaux appelés à statuer sur le mariage homosexuel de Bègles l’ont annulé sur le fondement du code civil et de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans toutes les sociétés, depuis des millénaires, le mariage est un contrat destiné à sceller l’alliance de l’homme et de la femme. De plus, il n’y a pas d’injustice à exclure les homosexuels du mariage parce qu’ils sont libres de vivre en communauté de vie organisée. L’indifférenciation des sexes dans le mariage repose sur une conception abstraite de l’égalité qui ne vaut pas pour le mariage : l’égalité des époux a été acquise à partir des années 1960 mais cette révolution silencieuse suppose justement la différence des sexes. Je crois que la consécration du mariage homosexuel serait de nature, à terme, à remettre en cause la structure même du droit de la famille basée sur la différence généalogique des lignes paternelle et maternelle. La déstructuration des institutions civiles de la famille me paraît dangereuse.
En tant que citoyenne, je me demande si le mariage homosexuel est exempt de risques politiques et sociaux affectant la conception de la République. En 1792, le mariage civil a réalisé l’unité des Français malgré leurs différences religieuses : ce fut un facteur de paix sociale. Si le mariage homosexuel était consacré par la loi, les grandes religions dotées d’un droit de la famille – catholique, juive, musulmane – pourraient demander que le mariage civil ne soit plus un préalable nécessaire à la célébration religieuse. Il y a là un risque de retour de l’autorité des droits religieux et de repli communautariste.
source : LE MONDE, édition du 11.04.07
Je passerai sur le “dans toutes les sociétés, depuis des millénaires…”
M’intéresse particulièrement le passage que j’ai souligné, parce qu’il relie plusieurs thèmes qui me sont chers : des questions de droit, de religion, d’homosexualité et de mariage. La professeure Labrusse-Riou commence par lier, assez étrangement, République et mariage civil. La Constitution de 1791, qui instaure une monarchie constitutionnelle, déclare (titre 2, article 7) que “La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.” Mais plus concrètement, la loi du 20 septembre 1792 “qui détermine le mode de constater l’état civil des citoyens” va préciser qui marie (et qui épouse qui : l’âge minimal, pour les filles, est treize ans…). [La République est proclamée le 23 septembre]
Dire que “ce fut un facteur de paix sociale” est un peu anachronique : le début des années 1790 est aussi une période de fracture de l’Eglise catholique, sommée d’accepter la “constitution civile du clergé”… Les “mariages sans Dieu” ne furent pas facilement acceptés.
L’inscription de longue durée du mariage civil n’est cependant pas un acte républicain, sauf à faire du Premier Consul l’incarnation de la République… Le caractère civil du mariage est imposé à l’Eglise catholique romaine dans un des “articles organiques” [i.e. “qui organisent”] du Concordat. L’article 54 précise que les curés “ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil”. Autant le Concordat a été négocié avec le pape de l’époque (Pie VII), autant les articles organiques ne le furent. Dans le cadre des “cultes reconnus”, un régime qui court de 1802 à 1905, le mariage civil est donc nécessaire avant que des semi-fonctionnaires (le clergé catholique, protestant puis juif) puissent célébrer le mariage religieux. Ce régime a tenu indépendemment du régime politique — Consulat, Empires, Monarchies, République… — et il serait anachronique donc de considérer simplement le mariage civil comme lié à la “laïcité” (même s’il laïcise incontestablement) ou à la République.
Le Code civil de 1804 précise aussi les conditions pratiques du mariage. Le code pénal de 1810 prévoit même des peines pour le clergé qui célèbrerait des mariages religieux sans avoir vérifié l’état matrimonial des époux :
ARTICLE 199.
Tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage, sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil, sera, pour la première fois, puni d’une amende de seize francs à cent francs.
ARTICLE 200.
En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en l’article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir,
Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans ;
Et pour la seconde, de la déportation.
source : Code pénal de 1810, Livre 3, Titre premier, chapitre 3, section 3, paragraphe premier
On reconnaîtra ici aisément que la déportation est peut-être une peine un peu forte pour un curé résistant à l’emprise du pouvoir séculier sur des prérogatives religieuses… Mais il faut prendre cela comme un signe que l’instauration du mariage civil, loin d’avoir miraculeusement assuré la “paix sociale”, avait besoin des forces de polices pour s’incarner concrètement dans les comportements des Français.
Ce qui semblait « logique » dans le contexte où les ministres du culte étaient des quasi-fonctionnaires est interrogé au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, en 1905. Mais les articles 199 et 200 restent en vigueur. En 1945, l’amende est actualisée (Ordonnance du général De Gaulle du 4 Octobre 1945) et perdure jusqu’en 1994, au moment où la peine est adoucie : l’emprisonnement maximum est réduit à six mois. Aujourd’hui le texte est rédigé ainsi :
Code Pénal, Article 433-21
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Ces possibilités de condamnation n’ont pas été souvent contestées. Au cours du XXe siècle, quelques prêtres et au moins un évêque ont été jugés pour y avoir contrevenu (en 1906, 1923 et 1976). Mais cela ne signifie pas qu’elles n’aient jamais été contestées, au contraire. Pour reprendre l’expression de Labrusse-Riou, “les grandes religions dotées d’un droit de la famille” n’ont pas toujours accepté l’état du droit séculier de la famille : demandez-donc au Pape si le mariage est un contrat civil. Le divorce — établi en France, de manière définitive jusqu’à présent, par la République, en 1884 — est par tout autant fortement critiqué par l’Eglise romaine.
L’idée que les revendications d’égalité devant le droit séculier devraient être ignorées sous prétexte que des religions — aussi “grandes” soient-elles — auraient elles-aussi des revendications est ridicule (et pourrait apparaître comme la reconnaissance institutionnelles de “communautés” dans la “République”). Surtout quand le point en discussion est “demander que le mariage civil ne soit plus un préalable nécessaire à la célébration religieuse”… Dans un régime de séparation, l’on pourrait s’attendre à ce que les actes religieux n’aient aucune valeur pour l’Etat… et que ce dernier n’impose pas de test au clergé. Le mariage est dans cet exemple un cas particulier : il n’est pas imposé à l’Eglise qui baptise de vérifier que l’enfant a bien été déclaré à l’état civil, ni, lors des obsèques, que la mort a bien été constatée. Le mariage semble être dans une situation particulière, comme point de contact entre sphères séculières et religieuses, mais cette situation n’est pas particulière à la France [une situation inversée existe aux Etats-Unis, par exemple, où la séparation des Eglises et de l’Etat s’accommode de clergé agent of the state quand ils marient].
Catherine Labrusse-Riou, en mobilisant sur le champ des débats politiques “République”, menace de “repli communautariste”, “paix sociale”… déploie de merveilleux épouvantails, qui ne résistent pas aux moineaux de la contextualisation.

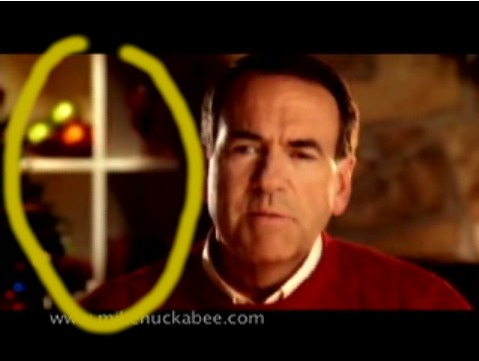 Regardez la publicité pour vous convaincre.
Regardez la publicité pour vous convaincre.