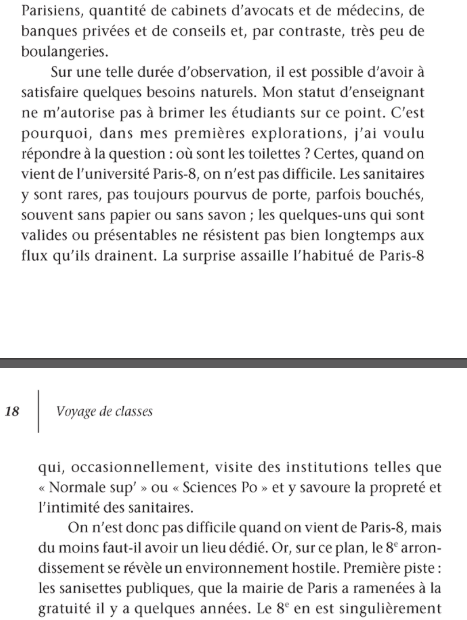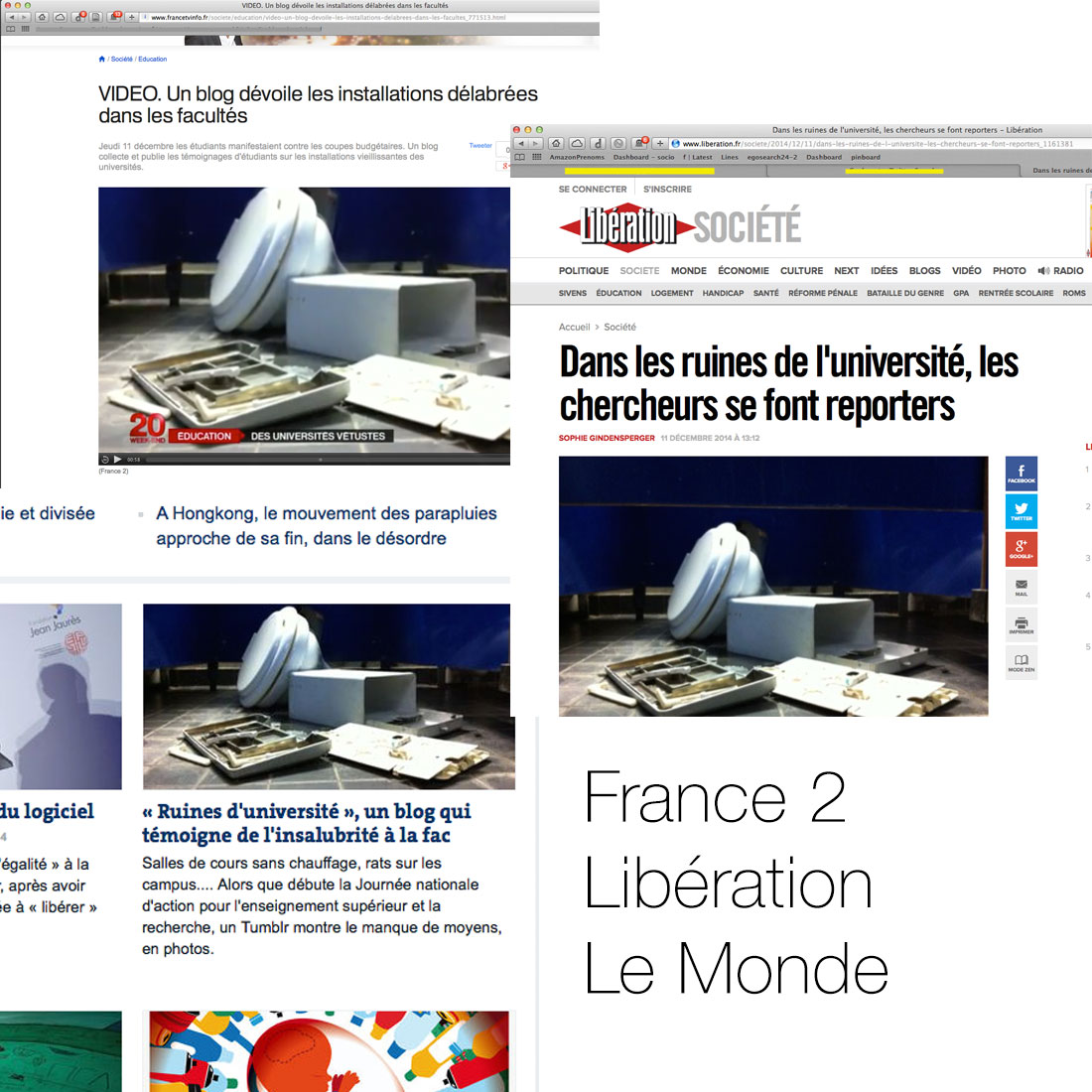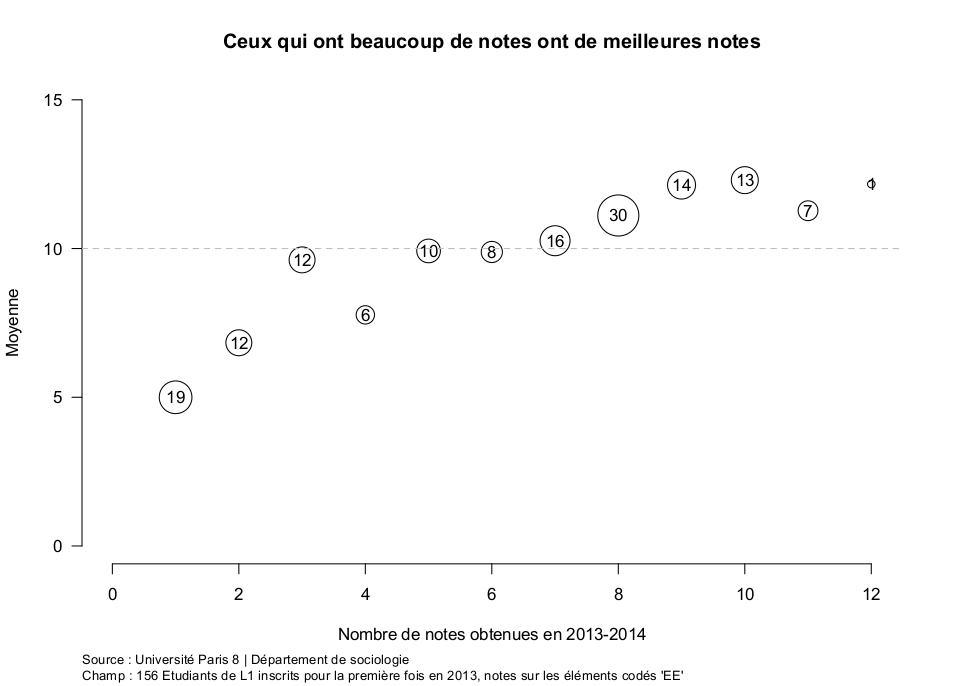Une formation à l’enquête : POF-ETUPOL
Cette année, dans le cadre du Collectif POF, un dispositif autogéré de formation à l’enquête quantitative en licence de sociologie, l’ENS Paris-Saclay et l’UVSQ ont mis leurs forces en commun. Le thème de l’enquête, cette année : les étudiants et la politique, l’engagement étudiant, en lien avec les expressions en ligne, sur les réseaux sociaux.
L’enquête, qu’on a nommé ETUPOL, dans neuf université et l’ENS Paris-Saclay, a permis de récolter plus de 13 000 questionnaires. Comme le montre Mathieu Ferry sur son blog, enquêter, en tant qu’étudiant, à l’université, ce n’est pas de tout repos :
Dans 19 salles, la non-passation correspond à des refus de passation explicites de la part de l’enseignant·e. Les raisons de ces refus de passation qui ont été remontées sont principalement liées à une évaluation en cours, à la réalisation d’exposés difficiles à interrompre, à un cours dense dans un programme “en retard”. Quelques enseignant·es déclarent ne pas avoir été prévenus de la passation de l’enquête, malgré l’affichage…
 Avec un financement de l’université Paris-Saclay, nous avons aussi pu organiser une journée d’étude « étudiante », à l’ENS Paris-Saclay à la fin du mois d’avril. En présence des enseignant·e·s du dispositif, des étudiant·e·s de L2 et L3 de l’UVSQ, de l’ENS et de l’université Paris 8 ont pu présenter les premiers résultats de l’enquête, avec des étudiants de master de l’université Paris 1, qui avaient participé à une enquête sur des thèmes proches, l’année dernière.
Avec un financement de l’université Paris-Saclay, nous avons aussi pu organiser une journée d’étude « étudiante », à l’ENS Paris-Saclay à la fin du mois d’avril. En présence des enseignant·e·s du dispositif, des étudiant·e·s de L2 et L3 de l’UVSQ, de l’ENS et de l’université Paris 8 ont pu présenter les premiers résultats de l’enquête, avec des étudiants de master de l’université Paris 1, qui avaient participé à une enquête sur des thèmes proches, l’année dernière.
Il faisait beau et, entre la session du matin et celle de l’après-midi, le déjeuner a eu lieu sur l’herbe, dans le jardin de l’ENS.

Quatre travaux étudiants, de groupes de l’UVSQ, ont été édités, notamment pour garder trace de l’enquête et de son utilisation, mais aussi parce que, de la rédaction des questions à la publication des résultats, ce dispositif fait voyager les étudiant·e·s dans tous les métiers de l’enquête quantitative :

Ces travaux sont en ligne sur le site du Collectif POF. Et, pour le cas précis de l’ENS Paris-Saclay, j’ai déjà parlé ici des normaliens dans les réseaux.