Le petit remplacement : note sur la fécondité des nobles (d’apparence)
À la fin du XIXe siècle, les bébés à particule ne représentaient que 0,4% des naissances. À la fin du XXe siècle, 100 ans après, ils représentent 0,9% des naissances. Comment expliquer cela ? Une hypothèse, c’est de dire que les “de Souza” ont remplacé les “de Rochechouart”, et qu’on n’est même plus chez nous en France, hein !
Mais il semble que d’autres hypothèses moins farfelues soient envisageables, ma bonne dame, si seulement vous étiez moins xénophobe.
Je commence par retenir les noms de famille n’apparaissant qu’une seule fois dans les naissances de la fin du XIXe siècle : entre 1890 et 1914, ces familles n’ont produit qu’un seul bébé. J’examine ensuite combien de bébés sont produits vers 1980, en comparant les noms à particule et les autres noms. La méthode est grossière, mais elle permet probablement de comparer la fécondité des descendants de noms très rares, présents en France à la fin du XIXe siècle, à celle des personnes portant un tel nom rare à la fin du XIXe siècle.
Pour être plus précis : Prenons les familles qui n’ont qu’un seul enfant à la fin du XIXe siècle, qui ont moins de 5 enfants 25 ans après, moins de 17 50 ans après et moins de 64 75 ans après. C’est une manière de retenir principalement les familles qui n’augmentent pas grâce à l’immigration mais surtout par la fécondité naturelle (en produisant au maximum 4 enfants tous les 25 ans).
7732 familles “nobles” correspondent à ce cas. Lors de la dernière période, elles ont produit 8238 enfants, soit une croissance de 1,06.
Les familles non-nobles sont plus nombreuses. Mais en fin de période, elles n’ont plus que 0,81 enfant pour chaque enfant produit à la fin du XIXe siècle. (Pour repérer cela, et avoir une idée du rapport plus élevé des nobles d’apparence, je prends 3000 échantillons de non-nobles de même taille que la population des familles à particule d’un même niveau de rareté).
De la même manière, comparons les familles qui, à la fin du XXe siècle, ont 2 enfants (puis moins de 9, moins de 33 et enfin moins de 129). Les “nobles” se retrouvent avec 1,6 enfants pour chaque enfant de la fin du XIXe, les non nobles avec seulement 1,3 enfants.
Un dernier exemple : les familles qui démarrent avec 3 enfants : si elles ont une particule, elles produisent en fin de période 1,9 enfant pour chaque enfant; les familles sans particules n’en produisent que 1,4. Avec 4 enfants : 1,9 pour les nobles, 1,4 pour les manants.
Dans tous les cas, les familles à particule présentes en France à la fin du XIXe siècle et très rares semblent avoir une fécondité plus importante que les familles sans particule. Ou alors elles arrivaient mieux à transmettre leurs noms (mais comment le feraient-elles ?). Est-ce parce qu’elles se trouvent, plus souvent, au sommet de l’échelle sociale et qu’elles disposent d’un patrimoine plus fourni ? Qu’elles sont plus souvent que de coutume catholiques ? Qu’elles connaissent une mortalité infantile moindre ?
Les grandes familles sont des familles nombreuses (du moins un peu plus nombreuses).
Un autre indice des différences de fécondité peut être calculé à partir de la proportion de noms qui disparaissent, qui cessent de produire des bébés.
80% des noms sans particule très très rares à la fin du XIXe siècle ne produisent aucun bébé à la fin du XXe siècle. Ce n’est le cas que de 75% des noms à particule aussi rares. La différence est faible, mais elle signifie que les noms à particule très rares il y a 100 ans se maintiennent mieux sur la distance : et la comparaison entre nobles d’apparence et manants d’apparence est toujours au profit des gens à particule.
Note finale : n’étant pas démographe, il est fort possible que ma lecture et mon analyse du fichier des patronymes soit une hérésie.


 Sur le site de l’Académie française, vous pouvez faire une “recherche avancée” pour retrouver un “Immortel”. Vous pouvez chercher par “numéro de fauteuil”, par nom ou par lieu de décès… ou par titre de noblesse. Pas par sexe, parce que les Immortels n’ont pas de sexe. Ont-ils une particule ?
Sur le site de l’Académie française, vous pouvez faire une “recherche avancée” pour retrouver un “Immortel”. Vous pouvez chercher par “numéro de fauteuil”, par nom ou par lieu de décès… ou par titre de noblesse. Pas par sexe, parce que les Immortels n’ont pas de sexe. Ont-ils une particule ?

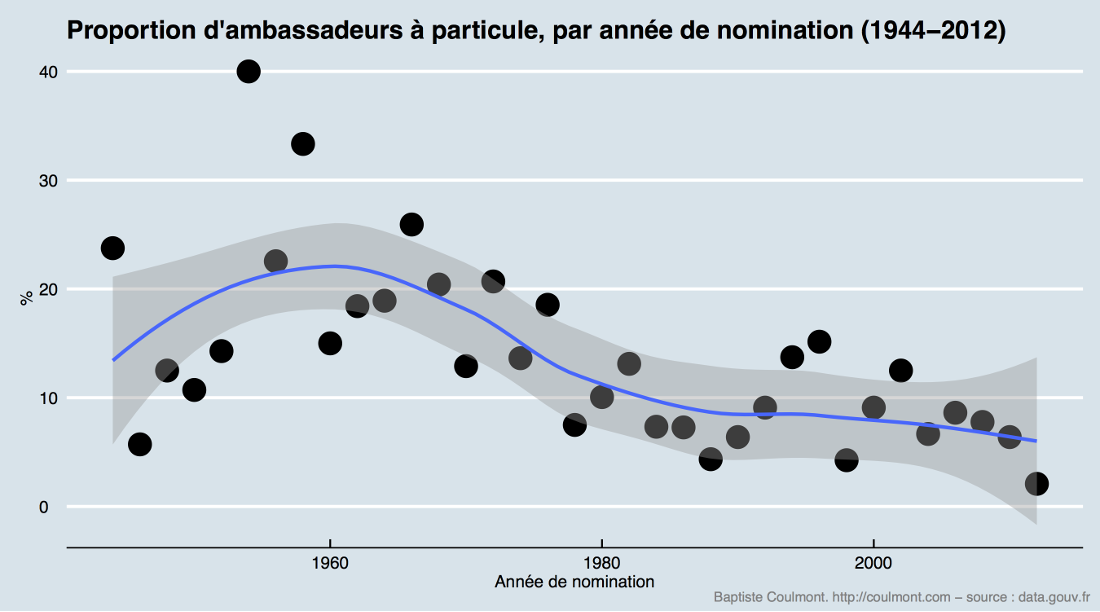
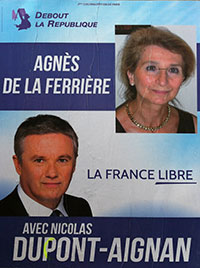 Dans “L’interdiction” de Balzac (une des nouvelles de la Comédie humaine), le narrateur se demande si, “pour commander”, il faudrait “ne point avoir connu d’égaux”. Et le narrateur de regretter l’évolution récente des lois et des mœurs, qui modifient les vocations naturelles des nobles.
Dans “L’interdiction” de Balzac (une des nouvelles de la Comédie humaine), le narrateur se demande si, “pour commander”, il faudrait “ne point avoir connu d’égaux”. Et le narrateur de regretter l’évolution récente des lois et des mœurs, qui modifient les vocations naturelles des nobles.

