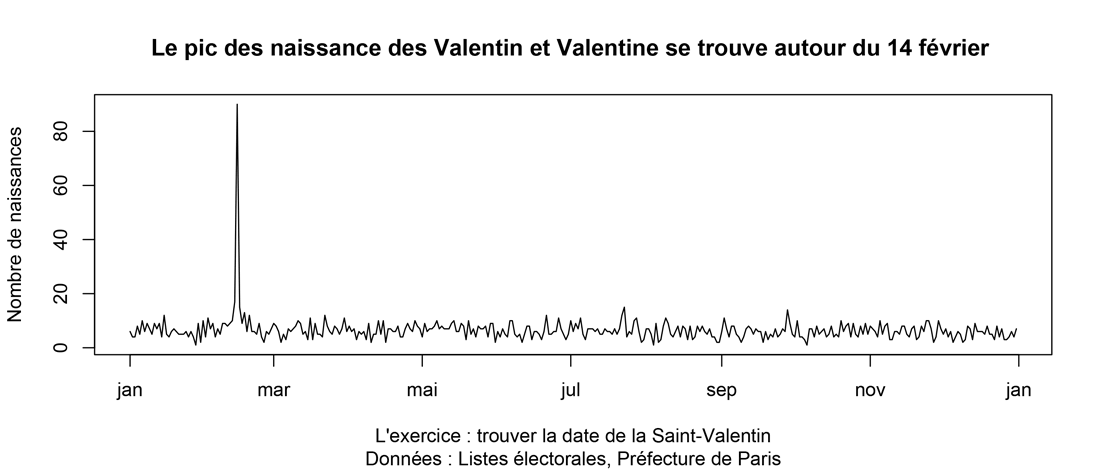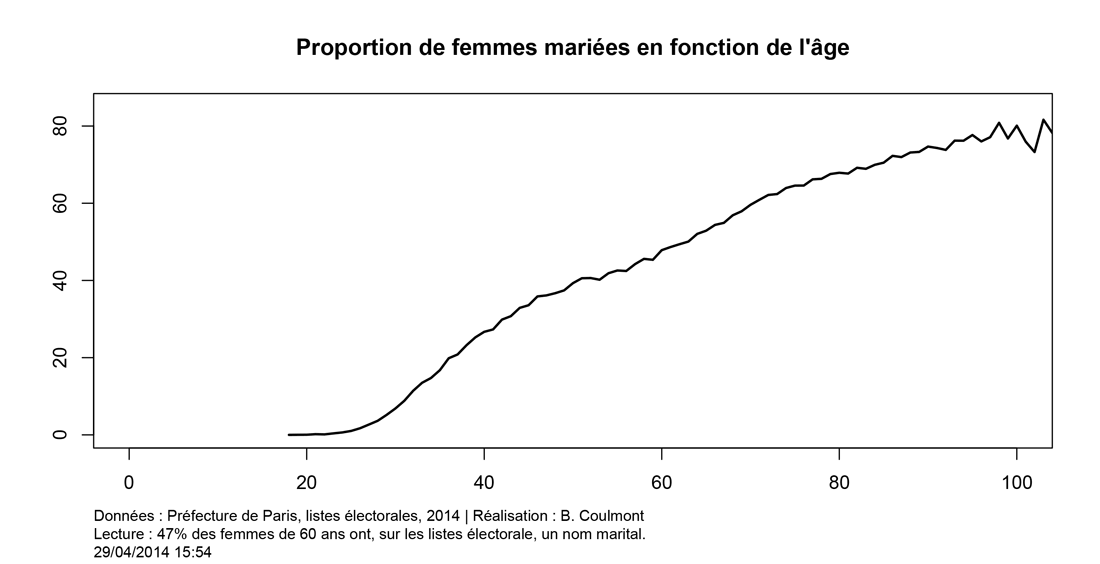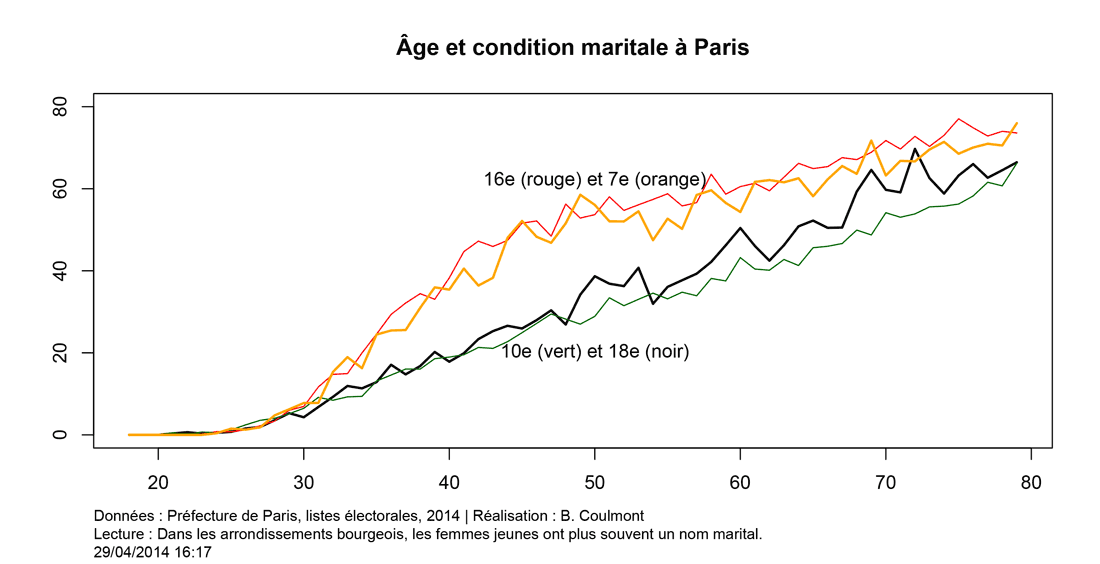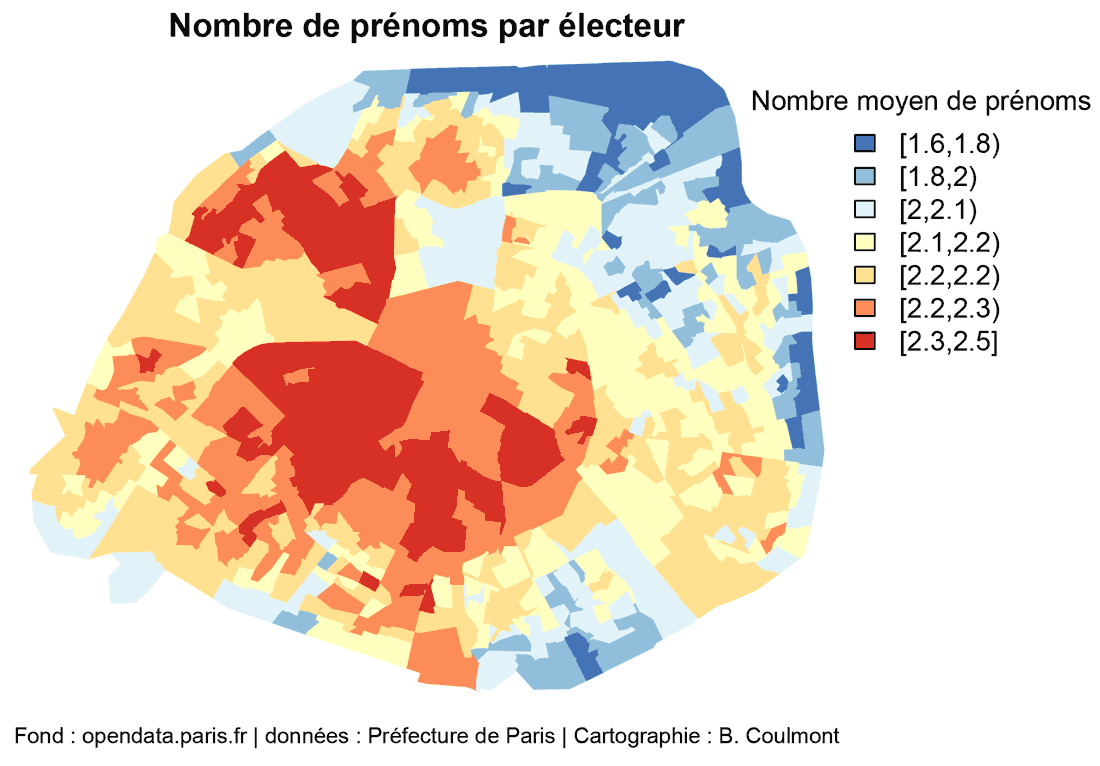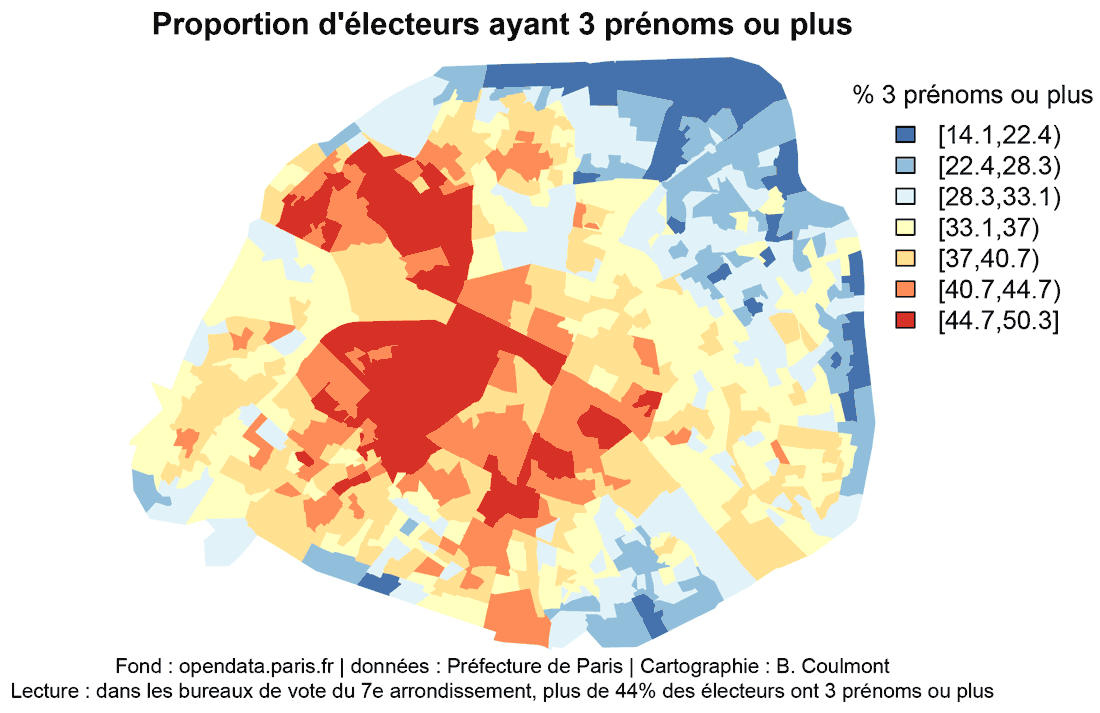À pied, en voiture, à cheval ou en métro ?
Comment se déplacent les Franciliens pour aller au travail ?
Voici une petite exploration à partir des données du recensement 2010 (disponibles sur le site de l’INSEE). Il y a trois possibilités : à pied, en voiture, ou en transport en commun. L’occasion de faire une analyse “ternaire”. Ici, le vert-vert signifie le recours à la voiture, le bleu le recours aux transports en commun, et plus cela tend vers le rouge, plus les pieds sont utilisés pour aller au travail.

Voici le “ternary plot” :
J’étais tombé sur une image proche visualisant les transports dans le grand-Londres, mais je ne sais plus où.
Et si vous me dites : « mais moi, je marche jusqu’à ma voiture et je roule jusqu’à la gare… » Je vous répondrai d’aller visiter le site de l’INSEE pour comprendre la construction des données.
Note : par “à pied”, il faut comprendre “sans aucun déplacement”, “à pied”, ou “en deux-roues”